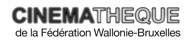Nouveautés
Algorithms of Beauty est une lettre adressée à une botaniste du 18e siècle par une cinéaste du 21e.
La botaniste créait des mosaïques florales avec du tissu tandis que la cinéaste fabrique des mosaïques d’images à l’aide des algorithmes d’une Intelligence artificielle.
Au fil de ses expériences, la cinéaste relate les succès et les échecs de fabrication de ses images. Inspirée par la botaniste, elle tente de s’approprier et de réinventer les modes de représentation qui sont à sa portée.
Algorithms of Beauty questionne les limites de notre regard, à travers une approche sensible de notre rapport à l’image, entre technologie et émotions.
Juillet 1996, la plage, la mer et le soleil. Sophie, 10 ans, passe ses vacances d’été avec sa mère et sa cousine Laurence. Mais Laurence a grandi et sa mère a la tête ailleurs. Alors que tout le pays est toujours à la recherche de deux petites filles disparues, Sophie va découvrir que ce sera son dernier été d’enfant.
Comment regarde-t-on l’enfance s’échapper, quand on risque de ne plus jamais voir ?
Pendant l'été 2016, en Europe, il y a le Football, mais aussi, une vague d’attentats. Dans l’euphorie d'une victoire italienne, Stéphane décide de faire la fête avec ses amis en boite de nuit. Mais à son arrivée, il se voit refuser l'entrée...
Court métrage sur le délit de faciès et le racisme, récompensé par le prix du meilleur court métrage aux Magritte du cinéma 2024.
Je pars en voyage et j'emporte avec moi : un os d'éléphant pour remuer la nourriture, une plume pour attraper les termites ailées, huit papillons, une corde faite de racines odorantes... et 150 mètres de film exposé mais pas encore développé destiné au ministère des Colonies.
Nobody has to know est sélectionné dans le cadre du Prix des lycéens du Cinéma 2023-2024 ! Si vous y êtes inscrit, nous vous encourageons vivement à découvrir les films avec vos classes au cinéma en priorité. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans la prise en charge des tickets d’entrée. Pour plus d’infos: prixdeslyceens@cfwb.be.
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Elle lui révélera bientôt leur plus grand secret : ils s’aimaient en cachette.
Rien à foutre est sélectionné dans le cadre du Prix des lycéens du Cinéma 2023-2024 ! Si vous y êtes inscrit, nous vous encourageons vivement à découvrir les films avec vos classes au cinéma en priorité. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans la prise en charge des tickets d’entrée. Pour plus d’infos: prixdeslyceens@cfwb.be.
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne low cost. Comme pseudo Tinder, elle a choisi Carpe Diem. Basée à Lanzarote dans les Canaries, elle compense son rythme de travail harassant par une vie de plage, de fête et de défonce ; au jour le jour et sans lendemain. Elle rêve encore d'une vie grand format et se répète que tout peut s'arrêter à tout moment, alors « rien à foutre ». Dans cette fuite en avant, Cassandre s'épuise et se voit disparaître. Mais pour elle, se reconnecter au monde veut dire prendre le risque d'affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol.
Dalva est est sélectionné dans le cadre du Prix des lycéens du Cinéma 2023-2024 ! Si vous y êtes inscrit, nous vous encourageons vivement à découvrir les films avec vos classes au cinéma en priorité. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans la prise en charge des tickets d’entrée. Pour plus d’infos: prixdeslyceens@cfwb.be.
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.
Temps mort est sélectionné dans le cadre du Prix des lycéens du Cinéma 2023-2024 ! Si vous y êtes inscrit, nous vous encourageons vivement à découvrir les films avec vos classes au cinéma en priorité. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans la prise en charge des tickets d’entrée. Pour plus d’infos: prixdeslyceens@cfwb.be.
Pour la première fois depuis longtemps, trois détenus se voient accorder une permission d’un week-end. 48h pour atterrir. 48h pour renouer avec leurs proches. 48h pour tenter de rattraper le temps perdu.
Un monde est sélectionné dans le cadre du Prix des lycéens du Cinéma 2023-2024 ! Si vous y êtes inscrit, nous vous encourageons vivement à découvrir les films avec vos classes au cinéma en priorité. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans la prise en charge des tickets d’entrée. Pour plus d’infos: prixdeslyceens@cfwb.be.
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.