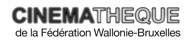Actualités
La Vie d’un lecteur au temps de la fin du livre (Luc JABON, 2004)
Un petit garçon reçoit des mains du rabbin son prénom à lécher, celui-ci ayant été tracé en lettres de miel. Le même sort nourricier est réservé au mot « maman » écrit à l’aide de nic-nac, mythique alphabet de biscuits secs. Ces images ne font qu’illustrer ce qu’on sait déjà, lire, comme toute activité intellectuelle, est autant affaire de corps que d’esprit. De même, il arrive que de simple loisir la lecture devienne un mode de vie. Cela reste néanmoins assez rare, voire de plus en plus rare.
L’Ile où dormait L’Age d’or (Isabelle DIERCKX, 2005)
L’histoire du monde est comme un puzzle surréaliste dont aucune pièce ne s’ajusterait vraiment et qui serait elle-même un puzzle dont aucune pièce ne s’ajusterait vraiment et qui serait elle-même un puzzle dont aucune pièce….
Guerre et paix en Irlande (Arthur MacCaig, 1998)
Le plus long conflit civil européen du XXème siècle (1968-1998) (ré)expliqué à l’aune du complexe ordonnancement des faits historiques. Didactique et clair, bien que sensible aux thèses républicaines, le travail d Arthur MacCaig se place tout entier dans la perspective d’une lente mais inexorable marche vers une paix, certes, toujours fragile, mais qui 15 ans plus tard, a prouvé toute sa solidité !
Le désordre alphabétique (Claude FRANÇOIS, 2013)
La lune éclaire le monde d’une autre lumière, elle nous révèle d’autres apparences, d’autres ombres et d’autres reflets. D’autres interprétations possibles du réel. Claude François, le réalisateur de cet alphabet désordonné, la convoque dès la première image, évoquant la plume de Pierrot et le pouvoir des mots, au clair de lune. Les mots et les images, le sens des mots sur les images, les mots comme images, les images assemblées en énigmes qui génèrent d’autres images dont on perd le sens et qui pourtant portent leur propre sens… Il n’est pas besoin d’être un artiste pour être surréaliste, dit Jean Wallenborn (physicien et poète), le surréalisme est une éthique, une manière d’être qui remet en cause la société et la pensée commune. Et la lune nous rappelle éclairant la lettre D, qu’il nous faut garder la distance, toujours pour regarder le monde.
Austerlitz, la victoire en marchant (Jean-François DELASSUS,2006)
Le récit de l’un des plus brillants succès tactiques du jeune empereur Napoléon Ier en 1805, vécue du dedans, au travers des acteurs qui y ont pris part, et avec le recul critique d’observateurs de la chose historique aux points de vue éclairants.
Polders – Les Noces de la Terre, de l’Eau et du Ciel (Claudio SERUGHETTI, 1998)
Un homme marche dans l’obscurité, une lanterne à la main. Le bruit du ressac occupe l’espace. Eaux profondes éclairez-vous… La voix du poète se superpose à celle de la mer et le regard suit une barque vide qui flotte sur une eau tranquille comme emportant le songe des mots. Eaux profondes révélez-vous…
Les Allumés de la foi (Richard OLIVIER, 2005)
Richard Olivier dresse le portrait croisé de trois « originaux » qui vivent leur foi dans le Christ de manière bien peu orthodoxe, en marge des institutions officielles et des usages courants, et qui, à leur manière, nous interpellent sur notre propre relation à cet « acte de croire (ou croyance) », partagé ou non.
Au gré du temps (Dominique LOREAU, 2006)
Il ne faut pas plus d’une heure pour assister à la naissance et à la mort de trois œuvres de Bob Verschueren. En vrai, il faudrait un peu plus longtemps, quelques jours, une semaine peut-être, guère davantage. Car il s’agit d’un art de l’éphémère prenant chair et souffle dans un temps et un lieu déterminés. Au gré du temps le suit dans son travail : déblaiement d’un terrain vague, installation de roseaux sur une plage, pommes crues étalées sur le sol d’un préau.
Chaumière (Emmanuel MARRE, 2013)
Dans l’imaginaire littéraire, l’hôtel est entouré de l’aura romantique du voyage, du luxe, de « la belle vie ». C’est une parenthèse de style, à l’opulence plus ou moins généreuse selon les cas. C’est une rupture du quotidien pour un confort temporaire parfois un peu honteux, parfois un peu indulgent.